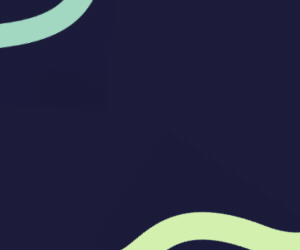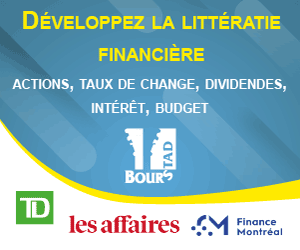Nouvelles
Enquête sur les cégeps Dawson et Vanier
Un beau tour de manège politique
Depuis sa plus tendre enfance, l’écrivain afro-américain Alex Haley entendait parler de son ancêtre, kidnappé en Gambie pour être réduit en esclavage aux États-Unis. Adulte, il s’est envolé pour l’Afrique dans l’espoir de confirmer la légende familiale.
Chroniques - Isabelle Hachey - La Presse
L’écrivain a raconté l’histoire de son ancêtre à un paquet d’experts tribaux gambiens. Ces derniers ont déniché un « griot », c’est-à-dire un conteur africain détenteur des traditions orales, qui a pu lui confirmer toute l’histoire, exactement comme sa famille la lui avait toujours racontée. Cela a donné le roman Racines, prix Pulitzer 1977.
Des années plus tard, on s’est rendu compte que le griot n’en était pas vraiment un et n’avait fait que reformuler l’histoire qu’Alex Haley avait lui-même racontée aux experts gambiens.
On était devant un cas classique de diffusion circulaire, ou fausse confirmation. Tout ça pour dire qu’on tient un nouveau cas, québécois celui-là.
Ça concerne une conclusion-choc de l’enquête administrative ordonnée par le gouvernement caquiste afin d’évaluer si les collèges Dawson et Vanier avaient pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leurs élèves, dans le contexte explosif du conflit au Proche-Orient.
Accrochez-vous, ça tourne en rond. Ça spinne aussi fort qu’un gouvernement qui chercherait désespérément à justifier ses actions.
Diffusé vendredi dernier, le communiqué de presse du cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a braqué les projecteurs sur l’un des constats les plus troublants du rapport d’enquête. Extrait du communiqué :
« Les principes de la laïcité ne sont pas respectés dans les deux établissements. Toujours selon l’enquête, la présence de salles de prière alimente un climat de radicalisation, de repli communautaire et de méfiance réciproque à l’intérieur du cégep 1 ».
Ce n’est pas rien, ce constat. C’est percutant. Au point que, le jour même, La Presse Canadienne a choisi d’en faire l’amorce d’un article sur le sujet : « Un nouveau rapport du gouvernement du Québec indique que les salles de prière alimentent un climat de radicalisation et de méfiance dans les collèges de la province 2 ».
Bien qu’il s’agisse d’un constat majeur, nulle part, dans le rapport d’enquête de 71 pages, on ne retrouve un fait ou un témoignage pour l’étayer. « Certains établissements » disposent de locaux de prière, mentionne simplement le rapport, qui prévient :
« Mais loin de contribuer au mieux vivre-ensemble, cela ne fait qu’alimenter un climat de radicalisation, de repli communautaire et de méfiance réciproque à l’intérieur du cégep 3. »

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE
Le collège Vanier est situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent
Pour toute référence, le rapport cite un texte d’opinion publié dans La Presse en 2023 et signé par un groupe de militantes québécoises en faveur de la laïcité, parmi lesquelles Nadia El-Mabrouk et Fatima Aboubakr.
Ce texte d’opinion rappelle qu’en 2015, un local avait été mis à la disposition des élèves du collège de Maisonneuve pour la prière du vendredi. Il souligne que cette concession n’avait rien fait pour améliorer les choses, bien au contraire :
« Loin de contribuer au mieux vivre-ensemble, cela n’a fait qu’alimenter un climat de radicalisation, de repli communautaire et de méfiance réciproque à l’intérieur du cégep 4. »
Et voilà. Il était donc question d’une situation particulière survenue il y a dix ans au cégep de Maisonneuve, où un groupe d’élèves radicalisés étaient partis combattre en Syrie.
Le rapport reprend intégralement les mots du texte d’opinion en les expurgeant de ce contexte particulier. Dans son communiqué de presse, le cabinet de la ministre présente cela comme un constat de la situation actuelle aux cégeps Dawson et Vanier !
Pas trop étourdis ? Tant mieux, parce que ça n’a pas fini de tourner.
Mercredi, Le Devoir a publié un texte d’opinion qui déplore que l’établissement de salles de prière à Dawson et à Vanier ne se soit « pas fait sans heurts ». Pour appuyer cet argument, le texte cite évidemment le rapport :