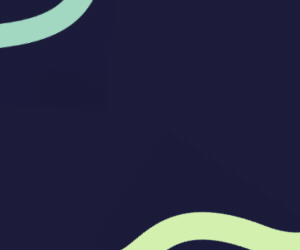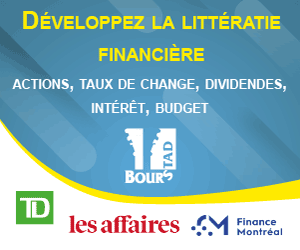Nouvelles
Opinion
Une réflexion sur la laïcité dans les cégeps s’impose
Nadia El-Mabrouk, Fatima Aboubakr, François Dugré, Marie-Claude Girard, Etienne-Alexis Boucher, Raphaël Guérard, Lyne Jubinville et Lucie Jobin
Les auteurs cosignent ce texte au nom du Rassemblement pour la laïcité.
Lettre d'opinion publiée dans Le Devoir
Dans le contexte de la guerre à Gaza, de virulentes manifestations ont eu lieu dans certains cégeps et dans des universités de Montréal, donnant lieu à de l’intimidation et à un climat délétère. C’est à la suite de diverses plaintes que la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a commandé une enquête dans les collèges Dawson et Vanier.
Le rapport qui vient d’être publié identifie des associations étudiantes à la source de ce climat toxique. Celles-ci agiraient en contravention avec leurs propres statuts. Par exemple, il est indiqué que Solidarity for Palestinian Human Rights Dawson (SPHRD) affiche son appartenance à « des mouvements activistes à caractère sociopolitique », ce qui contrevient à sa constitution affirmant que le club ne doit pas être de nature politique. D’ailleurs, les enquêteurs soulignent que les activités organisées par ces clubs ne favorisent en rien « la compréhension et la camaraderie entre tous les secteurs de la communauté », mais créent plutôt des dynamiques d’exclusion donnant lieu à des tensions.
Les enquêteurs soulèvent aussi la difficulté de distinguer « ce qui relève de la culture et ce qui relève du religieux » dans les activités des associations telles que la SPHRD, mais aussi la Muslim Student Association, la Jewish Student Association ou encore l’Islamic Relief, cette dernière formant, selon plusieurs sources, une branche de l’organisation des Frères musulmans. Or, si la culture, ou même la politique, est bien au cœur de la vitalité académique des cégeps, il n’en va pas de même de la religion qui relève de croyances et facilite le cloisonnement communautaire.
Comment s’étonner du climat délétère provoqué par ce foisonnement de groupes à caractère religieux, particulièrement dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient ? Cela a en outre pour conséquence d’instaurer un climat de dévotion dans un établissement qui devrait être destiné au savoir, et provoque une surenchère de demandes d’accommodements religieux, créant une pression indue sur la direction des collèges et des cégeps et sur certains étudiants.
Le rapport indique d’ailleurs un aménagement des examens et des activités pédagogiques en fonction des diverses fêtes religieuses. Une salle de prière pour musulmans et une autre pour juifs sont même présentes au collège Dawson, alors que le collège Vanier dispose d’une salle de prière aménagée pour les musulmans, avec rideau séparant les femmes des hommes !
Mais cela ne se fait pas sans heurts. Les enquêteurs estiment que « loin de contribuer au mieux vivre-ensemble, cela ne fait qu’alimenter un climat de radicalisation, de repli communautaire et de méfiance réciproque à l’intérieur du cégep ». De plus, l’affectation d’une salle à une confession religieuse particulière est considérée « comme un privilège, peut être vue comme du prosélytisme et est discriminatoire face aux étudiants appartenant à d’autres confessions religieuses ». Ayant songé à transformer la salle de prière musulmane du cégep Vanier en salle multireligieuse, le projet n’a pu être réalisé en raison d’un « droit acquis » pour les musulmans.
Qu’en est-il de la laïcité des cégeps ?
« Comment peut-on considérer qu’une salle de prière constitue un droit acquis dans un collège qui doit respecter les articles 2 et 3 de la Loi sur la laïcité de l’État stipulant que les principes de la laïcité doivent être respectés en fait et en apparence ? » demandent avec raison les enquêteurs.
En effet, bien que les établissements d’enseignement supérieur ne soient pas soumis à la directive du ministère de l’Éducation (MEQ) interdisant les pratiques religieuses dans les écoles, ceux-ci sont néanmoins tenus de respecter les principes de la laïcité, dont la neutralité religieuse. Mais voilà, l’ambiguïté persiste : la neutralité religieuse consiste-t-elle à accommoder toutes les religions, ou bien à n’en accommoder aucune ? Concrètement, dans le cas des lieux de prière, faut-il, comme le suggère l’agente des services sociaux du collège Vanier, répondre aux demandes religieuses des étudiants de toutes les confessions ou bien, comme l’exprime clairement la directive du MEQ, n’en considérer aucune ?
Dans cette directive du MEQ, on peut lire que « l’aménagement de lieux utilisés à des fins de pratiques religieuses dans une école […] est incompatible avec le principe de la neutralité religieuse de l’État ». L’interdiction de salles de prière y est notamment justifiée par le respect de la liberté de conscience des élèves qui doivent être protégés contre les pressions directes ou indirectes les incitant à se conformer à une pratique religieuse, et parce que de tels accommodements sont de nature à entraver le bon fonctionnement des écoles.
Tous ces arguments sont également valables pour les cégeps. Bien que plus âgés, les étudiants sont pour la plupart toujours mineurs à leur arrivée au collège. Par ailleurs, on ne peut ignorer que ces salles de prière ne sont pas toujours des lieux de recueillement paisibles, mais deviennent parfois des foyers de radicalisation et des lieux de recrutement pour des conflits à l’étranger.
Songeons, par exemple, au collège de Maisonneuve, qui fut, en 2015, le foyer de recrutement d’étudiants pour le djihad en Syrie. Afin de répondre à leur demande, la direction du cégep avait mis à la disposition des étudiants une salle pour les prières du vendredi, ce qui n’a fait qu’alimenter le climat de radicalisation, de repli communautaire et de méfiance réciproque à l’intérieur du cégep.
En conclusion de leur rapport, les enquêteurs recommandent de « mettre en place les mécanismes appropriés afin de s’assurer du respect et de l’application des articles 2 et 3 de la Loi sur la laïcité de l’État ». On ne peut que seconder cette recommandation ! Mais encore faut-il que la neutralité religieuse soit clairement définie, non pas comme une porte ouverte à toutes les demandes religieuses, mais bien comme l’absence de toute reconnaissance de celles-ci et du prosélytisme religieux dans les cégeps.
Et pour commencer, aucune accréditation ne devrait être accordée à un club étudiant à vocation religieuse. Du reste, la Loi sur les cégeps ne prévoit aucunement une telle chose.
Ce texte fait partie de notre section Opinion, qui favorise une pluralité des voix et des idées en accueillant autant les analyses et commentaires de ses lecteurs que ceux de penseurs et experts d’ici et d’ailleurs. Envie d’y prendre part? Soumettez votre texte à l’adresse opinion@ledevoir.com. Juste envie d’en lire plus? Abonnez-vous à notre Courrier des idées.