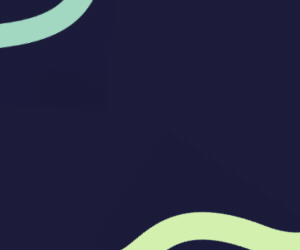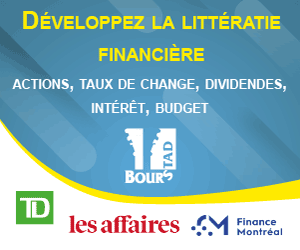Nouvelles
Chronique de Mathieu Bélisle
Les sujets qui fâchent
Nous pensions que le débat sur la liberté académique était derrière nous, et voilà qu’il resurgit à la faveur d’une affaire franchement inusitée. Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur, a déclenché une enquête dans les cégeps Vanier et Dawson sur la base de plaintes qu’elle aurait reçues à son bureau, en expliquant que la sécurité des étudiants était en jeu.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE
La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry
Vérification faite : à Vanier, les responsables ont affirmé n’avoir reçu aucune plainte à l’interne, tandis qu’à Dawson, la direction a confirmé qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les étudiants puissent faire ce qu’ils sont venus faire : étudier.
Non contente de déclencher une enquête qui donne aux fonctionnaires des pouvoirs extraordinaires, dont celui de contraindre les individus à témoigner, la ministre Déry a décidé d’intervenir auprès du cégep Dawson à propos d’un cours en particulier, intitulé « Appartenances palestiniennes », l’une des nombreuses déclinaisons d’un cours de français obligatoire.
La direction de l’établissement a confirmé que les étudiants qui éprouvaient un malaise à propos de ce cours avaient pu en choisir un autre parmi les dix-neuf options offertes, comme le rapportait Rima Elkouri jeudi1.
Et pourtant, la ministre n’en a pas démordu : elle a exigé, dans une intervention absolument inédite, que le contenu du cours en question soit revu. « Est-ce que, dans ce cours de français, on aurait pu éviter de parler d’enjeux plus sensibles et plus clivants ? », s’est-elle demandé.
D’abord, mettons une chose au clair : on peut aimer ou ne pas aimer l’idée d’offrir un cours portant sur la Palestine dans un cégep. Chacun a ses convictions, ses intérêts et sa sensibilité, et il est clair, à l’heure actuelle, que le conflit entre Israël et le Hamas suscite des tensions qui ont le potentiel de dégénérer.
Je suis persuadé que des étudiants juifs peuvent se sentir mal à l’aise, troublés, dérangés par des manifestations et des slogans, par la colère des uns et l’indignation des autres, de même que je ne doute pas un seul instant que bien des étudiants palestiniens doivent être au désespoir en voyant la bande de Gaza dans un tel état de destruction.
Mais sur le plan académique, aimer ou ne pas aimer un cours ne peut pas être un critère de sélection, sans quoi la définition des programmes risque d’être soumise aux humeurs du moment et à l’arbitraire des dirigeants.
Le critère doit être celui du savoir légitime. Y a-t-il des choses à apprendre au sujet de la Palestine, de son histoire, de sa culture et de sa littérature ? La réponse, me semble-t-il, ne peut être que oui.
C’est pourquoi je demande à la ministre : où faut-il tracer la ligne en matière de sujets « sensibles et clivants » ? Y a-t-il des bons et des mauvais sujets ? Et si oui, peut-elle nous en fournir la liste ?
Quand je regarde le descriptif des cours offerts dans les cégeps du Québec, aussi bien anglophones que francophones, je vois qu’on y aborde toutes sortes de sujets qui fâchent, ou qui ont le potentiel de fâcher : on y parle des grandes religions et des sectes, des questions de genre et d’orientation sexuelle, du colonialisme et du postcolonialisme, du féminisme et de l’égalité hommes-femmes, d’islamisme et de complotisme, de nationalisme et d’indépendance, des impérialismes américain, russe et chinois, etc.
Pourrait-on demander à des professeurs d’éviter l’un ou l’autre de ces sujets parce que des étudiants mal à l’aise sont allés se plaindre en haut lieu ?
Pourrait-on juger que des cours qui traitent de liberté d’expression et de censure, qui soumettent les religions au crible de la raison, qui parlent de violence sexuelle et d’avortement, des génocides et des guerres, des persécutions vécues par des minorités, ici comme ailleurs, doivent être revus ou retirés de l’offre sous prétexte qu’ils contredisent les convictions de certains étudiants ?
Et en littérature, quelles œuvres faire lire quand dans les romans, la poésie et le théâtre, présents comme passés, on trouve des visions du monde clivantes, des scènes sensibles, des mots qui heurtent ?
Si je pose toutes ces questions, c’est que l’intervention de la ministre ne donne pas l’impression qu’elle reconnaît aux professeurs et aux établissements leur capacité à exercer leur jugement.
Mme Déry ne semble pas non plus faire la différence entre l’inconfort suscité par le traitement d’un sujet sensible et l’existence d’un véritable danger. Le fait pour un étudiant de ne pas se sentir à l’aise ne signifie pas que sa sécurité est compromise.
Elle qui, dans une lettre publiée il y a deux ans, affirmait qu’« aucune censure n’a sa place dans les universités2 », juge-t-elle que pour les cégeps c’est différent ?
A-t-elle déjà oublié l’entente qu’elle a signée avec les professeurs de cégep l’été dernier, qui reconnaît leur « liberté d’enseignement, de recherche et d’expression », laquelle inclut « la liberté de déterminer les savoirs et les contenus essentiels à enseigner » et « la liberté de critiquer la société, les institutions, les paradigmes et les opinions, les lois, les politiques, les règlements et les programmes publics3 » ?
Bien sûr, ces libertés ne viennent pas sans responsabilités : tout enseignant doit faire preuve de rigueur et de professionnalisme, tenir compte de l’état des connaissances et respecter les lois — c’est l’évidence. Mais il faudrait que la ministre explique en quoi son intervention récente respecte les principes auxquels elle est censée souscrire.
Car dans le cas contraire, on ne peut faire autrement que conclure qu’elle a agi pour répondre à des intérêts particuliers plutôt que pour servir le bien commun, qu’elle a cherché à dicter le contenu d’un enseignement à des fins politiques, bref qu’elle a abusé de son pouvoir, ce qui, dans toute démocratie qui se respecte, soulève de sérieuses questions éthiques.
En agissant à l’encontre de la liberté académique alors même que son gouvernement a lancé une commission pour la défendre4, la ministre Déry donne aussi l’impression que cette liberté est à géométrie variable, qu’elle doit être défendue quand cela sert la vision et les intérêts du gouvernement, et bafouée quand elle ne les sert plus.