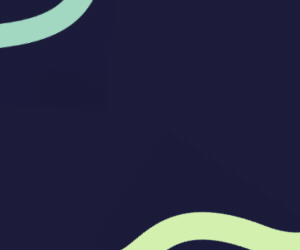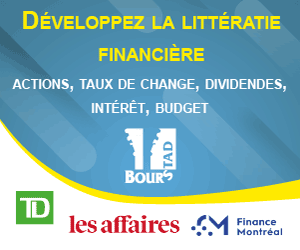Nouvelles
Surprotection dans le réel, surexposition dans le virtuel
Stéphane Kelly
L'auteur est sociologue et enseignant au Cégep de Saint-Jérome. Il publie le 26 août prochain l'essai L'enfant vieux (Boréal).
À la rentrée scolaire, cette année, une nouveauté attend les élèves des écoles secondaires : l’usage du téléphone cellulaire sera interdit. Cette mesure ne fait pas consensus, et elle suscitera des débats.
L’année dernière, dans un cours que je donne au cégep intitulé « L’école et l’enseignant », j’ai été étonné d’apprendre que plusieurs écoles secondaires dans les Laurentides appliquent déjà cette règle depuis quelques années. Mes étudiants m’ont raconté que cela se passe en général très bien ; cette mesure est jugée bénéfique.
Dans plusieurs pays, des livres importants ont été publiés, documentant les effets négatifs des écrans : aux États-Unis, Génération Internet (Jean Twenge), Génération anxieuse (Jonathan Haidt) ; en France, La fabrique du crétin digital (Michel Desmurget) ; en Angleterre, On vous vole votre attention (Johann Hari). Aujourd’hui, en moyenne, durant une journée, une personne touche à son cellulaire 2617 fois, pour une durée totale de trois heures et quart !
Pour éclairer le débat, il importe de rappeler quelques faits observés dans ces études. Plus le temps d’écran est élevé chez un jeune, plus c’est source de problèmes : moins de socialisation avec des amis (en personne), plus de solitude et plus d’anxiété. Certaines activités essentielles sont délaissées ou abandonnées (le sport, la pratique d’un art, la lecture) ; la capacité d’attention diminue ; les heures de sommeil aussi. Les jeunes sont nombreux à dormir avec leur cellulaire sous l’oreiller ; le déficit de sommeil épuise le cerveau.
Ces faits tendent à montrer que les difficultés de concentration ou d’apprentissage de beaucoup d’élèves n’ont pas une source chimique, mais plutôt numérique. Avant même le début des classes, le matin, de nombreux élèves ont déjà deux, trois ou quatre heures d’écran derrière la cravate… Est-il nécessaire de préciser que ce temps d’écran n’est pas occupé à lire un quotidien, un roman ou autre chose de nourrissant pour l’esprit ?
Ces élèves sont mal encadrés, à l’école comme dans la famille. Au lieu de leur faire découvrir la liberté, la société les a abandonnés à une forme distrayante d’esclavage. Dans un essai prophétique, Se distraire à en mourir, l’écrivain Neil Postman écrivait ce qui suit :
« Orwell craignait ceux qui interdiraient les livres. Huxley redoutait qu’il n’y ait même plus besoin d’interdire les livres car plus personne n’aurait envie d’en lire. Orwell craignait ceux qui nous priveraient de l’information. Huxley redoutait qu’on ne nous en abreuve au point que nous en soyons réduits à la passivité et à l’égoïsme. Orwell craignait qu’on nous cache la vérité. Huxley redoutait que la vérité ne soit noyée dans un océan d’insignifiances. Orwell craignait que notre culture soit prisonnière. Huxley redoutait que notre culture ne devienne triviale, seulement préoccupée de fadaises. »