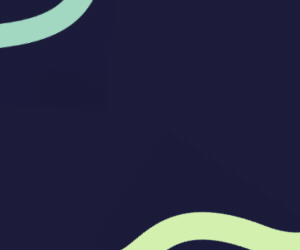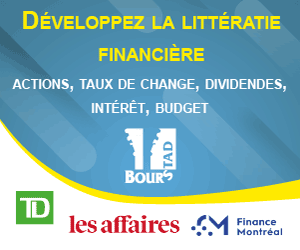Nouvelles
L’IA, un «tsunami» qui bouleverse les habitudes en enseignement supérieur
Zacharie Goudreault - Le Devoir -
Selon un sondage publié en octobre dernier, 59% des étudiants canadiens de 18 ans et plus utilisaient en 2024 l’intelligence artificielle dans le cadre de leurs travaux scolaires.
Les étudiants qui ont recours à l’intelligence artificielle (IA) générative sont de plus en plus nombreux, bouleversant le travail des professeurs de cégeps et d’universités qui tentent tant bien que mal de s’adapter à cette révolution technologique. Des balises claires de Québec se font, pendant ce temps, attendre.
« Tout le monde est affecté par ce tsunami qu’est Chat GPT », lance la professeure en technologie éducative à l’Université TELUQ Valéry Psyché. De récentes études montrent d’ailleurs que si l’IA générative est utilisée par une partie des professeurs, cette proportion est significativement plus grande chez les étudiants, qui s’en servent notamment pour préparer des présentations et résumer de longs documents, relève la professeure.
À lire aussi
Dans ce contexte, « comment est-ce qu’on peut demander des travaux qui permettent à nos étudiants d’apprendre réellement ? » se demande-t-elle.
Selon un sondage mené par la firme KPMG publié en octobre dernier, 59 % des étudiants canadiens de 18 ans et plus utilisaient en 2024 l’intelligence artificielle dans le cadre de leurs travaux scolaires, contre 52 % l’année précédente.
Ce coup de sonde montre par ailleurs que 67 % des étudiants qui ont recours à ces outils dans le cadre de leurs démarches scolaires « pensent ne pas apprendre autant ou retenir moins de connaissances » en raison de leur utilisation de ces systèmes.

Photo: Michaël Monnier Archives Le DevoirL’IA générative, en posant un risque évident de plagiat, force plusieurs professeurs à retourner à leurs anciennes pratiques d’évaluation prépandémiques.
Paresse cognitive ?
« Est-ce que les jeunes qui utilisent les systèmes d’IA finissent par développer une certaine forme de paresse cognitive et une diminution de l’usage de leur jugement critique ? À ce sujet, on peut avoir une intuition, mais ça a besoin d’être documenté davantage », relève en entrevue au Devoir le président de la Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST), Luc Bégin.
Les potentielles conséquences de l’utilisation de l’IA générative sur le délestage cognitif d’étudiants, qui verraient leur jugement critique ainsi diminué, figuraient d’ailleurs parmi les préoccupations listées dans un rapport sur l’usage de ces systèmes en milieu scolaire publié en avril 2024 par le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et la CEST.
Plus d’un an plus tard, M. Bégin se réjouit de voir qu’un nombre croissant de recherches se penchent sur les questions qui attendent d’être éclaircies quant aux impacts de l’usage de l’IA générative en enseignement supérieur.
« Il faut éviter la dépendance [à l’IA générative] et surtout la perte, la diminution de la capacité d’apprendre, de développer un esprit critique, prévient Mme Psyché. La paresse cognitive, c’est ça qu’on essaie d’éviter. »
L’IA générative pose par ailleurs le risque que la « fracture numérique », qui existait déjà entre les étudiants ayant accès ou non à des outils technologiques et à une connexion Internet de qualité, grandisse encore davantage. Certains étudiants risquent ainsi d’être favorisés par leur maîtrise plus grande des systèmes d’IA générative et par l’accès à certains outils payants, par exemple.
« Il y a une fracture qui s’agrandit, puis ça va extrêmement rapidement », prévient le chargé de projets pédagonumériques à l’Université du Québec à Montréal Yves Munn. Afin de limiter ces inégalités, « travailler sur le développement de la compétence numérique des jeunes », dans le système scolaire québécois, est essentiel, estime la présidente du CSE, Monique Brodeur.