Articles
Contrer la pénurie en soins infirmiers
Par Élise Prioleau

En septembre dernier, des hôpitaux de la province ont dû fermer des services hospitaliers par manque d’infirmières. Dans les cégeps, c’est un réel défi de recruter et de retenir les jeunes dans ce domaine mal coté depuis plus d’une décennie. Pour augmenter leur nombre de diplômés, de nombreux départements en soins infirmiers ont mis en place des stratégies ambitieuses pour soutenir leurs étudiant-e-s. Qu’est-ce qui a été fait pour rendre le programme de soins infirmiers plus attractif au collégial ? Comment enrayer la crise?
En septembre, une onde de choc a traversé les départements de soins infirmiers dans les cégeps. Le récent rapport des commissaires qui fait suite aux États généraux de la profession infirmière1 recommande de « faire du baccalauréat le seul diplôme donnant accès à un permis d’exercice de la profession infirmière au Québec dans un horizon de cinq ans ». L’objectif étant de « mieux préparer » les futures infirmières en rehaussant le niveau d’exigence de la profession. Bien que le rapport recommande aussi de maintenir le DEC-BAC comme parcours menant à la profession, plusieurs doutent de la pertinence d’exclure le DEC comme voie d’accès au métier.

Marlène McNicoll, présidente de l’Association des enseignants et enseignantes en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ).
« Il y a des jeunes qui disent que si le BAC était obligatoire, ils ne s’inscriraient pas en soins infirmiers. Le DEC est une porte d’entrée qui donne le goût à nos diplômées de poursuivre leur formation et de compléter le BAC », selon Marlène McNicoll, présidente de l’Association des enseignants et enseignantes en soins infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ).
De nombreuses détentrices du DEC choisissent en effet de poursuivre au BAC, comme le confirme le plus récent rapport statistique de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).« En plus de leur formation initiale, bon nombre d’infirmières et infirmiers poursuivent des études universitaires en sciences infirmières après l’obtention de leur permis. D’ailleurs, en 2019-2020, quelque 2 000 infirmières et infirmiers titulaires d’un DEC en soins infirmiers ont terminé leur baccalauréat en sciences infirmières en cours d’exercice 2», peut-on lire dans le rapport.
Rappelons que le Québec compte 77 000 infirmiers et infirmières. Sur ce nombre, environ 62 000 travaillent dans les établissements du réseau de la santé. Depuis cinq ans, le nombre d’infirmières ayant un DEC comme formation initiale a légèrement diminué. En revanche, elles sont encore près de 80% à être détentrices d’un DEC comme première formation, selon les plus récentes statistiques de l’OIIQ.
Attirer davantage d’étudiant-e-s en soins infirmiers
Nombreux sont les incitatifs qui ont été mis en place dans les cégeps pour attirer des étudiants en soins infirmiers. Les établissements collégiaux se sont dotés de pratiques et de technologies de pointe dans le domaine des soins infirmiers.
« On est en train d’introduire des cliniques-écoles dans chaque cégep. Le concept de clinique-école permet offre une opportunité de stage supplémentaire aux étudiantes dans les locaux du cégep, ce qui est sécurisant pour elles. On a aussi introduit des mannequins intelligents », explique Marlène McNicoll, présidente de l’Association des enseignants et enseignantes en soins infirmiers des collèges du Québec.
Les mannequins intelligents sont des humains de plastiques contrôlés à distance que l’on peut faire parler ou à qui l’on peut donner des symptômes. « C’est une technologie qui permet de faire vivre aux étudiants une situation réelle avec un patient. Ça permet de mieux préparer les étudiants avant leur stage clinique. Lorsqu’ils arrivent en situation réelle, les étudiants ont l’impression d’avoir déjà vécu la situation. Ça leur donne confiance », complète-t-elle.
Baisse du nombre d’étudiantes au DEC en soins infirmiers
En 10 ans, le nombre de demandes d’admission au DEC en soins infirmiers a diminué du quart. Tandis que certains cégeps de la métropole refusent des candidates par manque de place, des cégeps en région ont des places vacantes, selon les données du Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM) qui représente près de la moitié des cégeps du Québec.
Au Cégep de Baie-Comeau, les 25 nouvelles places disponibles dans le programme à l’automne sont comblées depuis deux ans. Le défi pour ce cégep de la Côte-Nord n’est pas tant de combler les places que de retenir les étudiants dans le programme jusqu’à la diplomation. Tous les ans, environ 12 étudiantes abandonnent le programme.
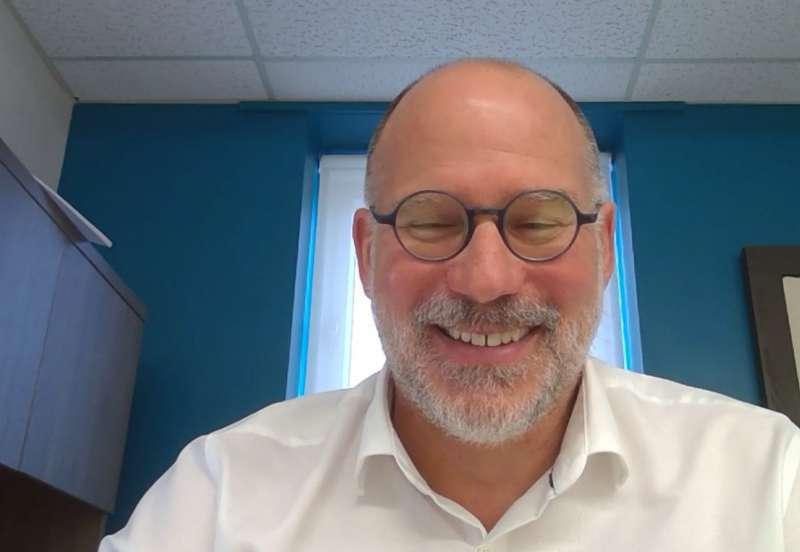
Marc Rochette, directeur des études au Cégep de Baie-Comeau.
« Les étudiantes qui abandonnent le font d’abord parce que le programme est chargé dès le départ. Ensuite, c’est le choc de la réalité. Lorsque nos étudiantes arrivent en stage et se rendent compte que commencer à travailler ça veut dire faire des nuits, faire des fins de semaine, être obligé de faire des heures supplémentaires, ça fait partie du choc de la réalité. L’autre raison qui explique les abandons, ce sont les échecs qui peuvent retarder d’un an le cheminement des étudiantes, qui se découragent parfois dans ces cas-là », explique Marc Rochette, directeur des études au Cégep de Baie-Comeau. « Nous pouvons agir sur les échecs, en soutenant davantage nos étudiantes, mais le choc de la réalité il est difficile à désamorcer pour une institution d’enseignement », termine-t-il.
Augmentation des étudiantes à Sherbrooke
Au Cégep de Sherbrooke, un groupe supplémentaire de 30 étudiantes a été ouvert il y a deux ans. Ce sont des partenariats mis en place entre le cégep et le milieu hospitalier sherbrookois qui ont attiré des recrues. « Nos étudiant-e-s bénéficient d’un processus d’embauche simplifié avec le CIUSSSE dès leur admission. Pendant leur parcours scolaire, ils peuvent rapidement acquérir de l’expérience en milieu hospitalier dans différents postes qui leur sont offerts en fonction du nombre d’années complétées dans le programme », explique Amélie Gauthier, enseignante et coordonnatrice en soins infirmiers au Cégep de Sherbrooke.

Amélie Gauthier, enseignante et coordonnatrice en soins infirmiers au Cégep de Sherbrooke.
« Les nouvelles étudiantes, par exemple, peuvent commencer à travailler comme agente administrative dès leur entrée dans le programme. Elles pourront accéder après deux et trois ans au poste d’externe en soins infirmiers et celui de candidate à l’exercice de la profession infirmière, sans pour autant perdre leur ancienneté lorsqu’elles changent de poste », précise la coordonnatrice.
Le Cégep de Sherbrooke a su relever le défi de la rétention des étudiantes admises. « On avait tendance à perdre 30 étudiant-e-s entre la première et la deuxième session, ce qui n’est plus le cas maintenant. L’an dernier, on a mis en place une équipe d’encadrement dédiée aux étudiants de première session, composée de professeurs avec qui les étudiants sont en contact dès la première session. On a aussi ajouté de l’encadrement en biologie qui était le cours écueil dans le programme. »
Les conditions de travail : un facteur déterminant
À l’unanimité, les formateurs en soins de santé au cégep déplorent la piètre qualité des conditions de travail dans le réseau. « La plupart des jeunes qui abandonnent le métier le font à cause des conditions de travail trop difficiles. Présentement, il y a un trop grand écart entre les aspirations des jeunes et ce que le marché du travail offre dans le milieu des soins infirmiers. Les jeunes aujourd’hui cherchent un équilibre entre le travail et la famille », selon Marlène McNicoll, présidente de l’AEESICQ.
C’est ce qui explique la baisse d’intérêt des jeunes pour ce métier depuis une décennie. « C’est sûr que s’embarquer dans un programme où l’on sait qu’on s’en va vers du temps supplémentaire obligatoire, ce n’est pas très attractif », reconnaît Amélie Gauthier, coordonnatrice en soins infirmiers au Cégep de Sherbrooke.
À cela s’est ajouté dans les dernières années, un phénomène nouveau : le départ d’infirmières débutantes qui choisissent de se réorienter. À ces problématiques, des solutions existent. Des recherches menées aux États-Unis dans les années 1980 ont démontré la corrélation entre la qualité des soins, la satisfaction des infirmières et la qualité des conditions de travail.
« L’abolition du temps supplémentaire, des quarts rotatifs pour avoir des infirmières d’expérience sur tous les quarts de travail, le mentorat pour les infirmières 0-5 ans, un ratio élevé de professionnelles par patient, le fait de placer les jeunes infirmières dans le champ d’activités qui les intéresse plutôt que de les faire changer de département tous les jours. Il a été démontré que ce sont des facteurs qui maintiennent les gens à l’emploi », conclut Amélie Gauthier.
1Les États généraux de la profession infirmière aux eu lieu les 20 et 21 mai dernier. L’événement a rassemblé différents intervenants du milieu de l’enseignement, du milieu de la santé et des citoyens. Il s’agit d’un rendez-vous initié par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
2Rapport statistique sur l’effectif infirmier 2019-2020, Le Québec et ses régions, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Montréal, 2020, p.24




