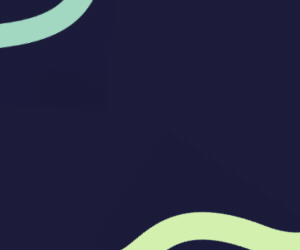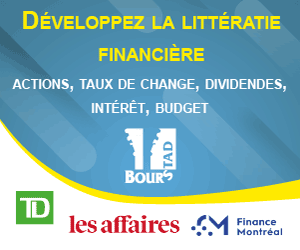Nouvelles
Opinion
Retourner à Spinoza, c’est «ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre»
Yves Gingras
L’auteur enseigne l’épistémologie des sciences sociales à l’UQAM.

Photo: Evert Elzinga Archives Agence France-Presse Une statue du philosophe Baruch Spinoza à Amsterdam
Un observateur du monde universitaire et intellectuel ne peut qu’être frappé par le caractère de plus en plus émotif des nombreux commentateurs qui s’expriment sur ce qui se passe aux États-Unis depuis le début de l’année 2025. Ainsi, une enquête du Devoir auprès de quelques professeurs d’université pour savoir « comment enseigner la politique américaine avec le retour de Trump ? » nous apprenait que certains professeurs, pourtant spécialistes des États-Unis, avaient été « choqués », avaient « vécu un moment un peu dépressif », au point que l’un d’eux — faisant curieusement disparaître toute distance avec son objet d’étude — disait même avoir « l’impression de perdre son pays ». On apprend aussi que des étudiants sortent des cours en pleurant et que « désormais, on ne peut plus nier la réalité » ! Comme si — en tant que chercheur universitaire, j’entends — on pouvait jusque-là nier la réalité au lieu de tenter de la comprendre.
Or, la mission première d’un chercheur universitaire étant de décrire, de comprendre et d’expliquer les phénomènes — que ce soient des choix politiques, des décisions électorales, des émeutes ou des discours divers — de manière rationnelle, il me semble plus qu’opportun dans le contexte géopolitique actuel — qui pousse à l’hystérisation — de rappeler la maxime du philosophe Baruch Spinoza (1632-1677) : « ne pas rire, ne pas pleurer, mais comprendre ».
Dans une lettre au savant anglais Henry Oldenbourg, écrite en octobre 1665 alors que l’Angleterre était en guerre contre la Hollande, Spinoza lui disait qu’en ce qui le concerne, « ces troubles ne l’incitent ni au rire ni aux pleurs », mais développent plutôt en lui « le désir de philosopher et de mieux observer la nature humaine ». Il ne trouvait pas convenable de « se lamenter à son sujet ».
Dans la troisième partie de son Éthique, portant sur les origines et la nature des « affections » (les passions humaines), il réitère son approche — qu’on dirait de nos jours « objectivante » — en notant que « ceux qui aiment mieux détester ou railler les Affections et les actions des hommes que les connaître » trouveront surprenant qu’il « entreprenne de traiter des vices des hommes et de leurs infirmités à la manière des Géomètres » et qu’il « veuille démontrer par un raisonnement rigoureux ce qu’ils ne cessent de proclamer contraire à la Raison, vain, absurde ou digne d’horreur ». Dans son Traité politique, il répète qu’il a mis tout son soin « à ne pas tourner en dérision les actions des hommes […], à ne pas les détester, mais à en acquérir une connaissance vraie ».
Spinoza exprimait ainsi clairement, en des termes aujourd’hui certes un peu désuets, la véritable mission de toute science : rendre raison des phénomènes, qu’ils soient naturels, sociaux, économiques, psychologiques, religieux ou autres.