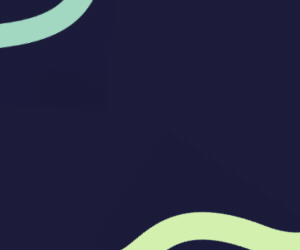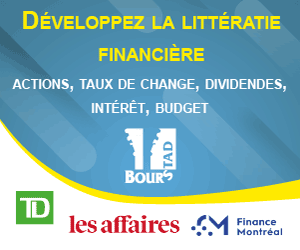Nouvelles
C’est quoi, un bon prof ?
La rencontre d’un enseignant inspirant est un accident du destin qui peut infléchir une vie. Mais qu’est-ce au juste qu’un bon prof ? L’actualité a enquêté.
Par Sophie Doucet - L'Actualité

Goodboy Picture Company / Getty Images
En anglais, en 4e secondaire, j’ai eu comme professeur monsieur B. Un timide au grand cœur qui faisait écrire et monter des pièces de théâtre dans la langue de Shakespeare à des ados unilingues francophones de Victoriaville. Nous jouions — avec décors et éclairages — devant un public tout aussi unilingue… qui en redemandait ! Je ne me rendais même pas compte que j’apprenais l’anglais. En littérature, au cégep, j’ai eu madame C. À la fois stricte et « flyée », elle n’hésitait pas à mettre au programme des œuvres réputées rébarbatives, comme Le Cid, de Corneille, ou Les anciens Canadiens, de Philippe Aubert de Gaspé, et nous invitait à pasticher La Fontaine et Ducharme ! Je lui suis redevable à vie.
Faites l’expérience : comptez le nombre de professeurs exceptionnels, inspirants qui ont croisé votre route depuis la maternelle. Ceux qui ont été des exemples, ont élargi vos horizons, vous ont transmis le virus de la littérature, des maths ou de la géographie, vous ont donné envie d’être créatif dans un domaine. La rencontre d’un bon enseignant est un accident du destin qui illumine ou infléchit notre vie. Elle colore la personnalité.
Le bon prof existe depuis que tourne le monde. L’œuvre de Platon est en partie un hommage à son maître, Socrate. Voltaire et Camus ont chanté les louanges de ceux qui les ont marqués, comme le fait Daniel Pennac dans Chagrin d’école. Le bon prof est célébré dans des films comme La société des poètes disparus, Les choristes ou Écrire pour exister, avec Hilary Swank, qui est basé sur une histoire vraie. Plus près de nous, Fabienne Larouche lui tire son chapeau dans Virginie.
Cet étrange animal fascine. De quel bois est-il fait ? Qu’est-ce qui, concrètement, le distingue de ses collègues ? Est-ce que ça s’apprend, être un excellent enseignant ? En cette ère où la réforme, la dictée et les compétences transversales font les manchettes, L’actualité a mené sa petite enquête auprès de spécialistes.
« Ce qui fait un bon prof tient de l’intangible ! » écrivait en 1950, dans le British Medical Journal, G. Patrick Meredith, professeur de psychologie. Chacun de ses maîtres avait été unique, mais tous avaient un truc en commun : « Ils semblaient s’intéresser autant à leurs élèves qu’à leur matière. » En disant cela, Meredith a mis le doigt sur quelque chose qui allait plus tard être confirmé par les recherches en pédagogie : la première passion du bon prof, ce sont ses élèves. « Même dans une grande classe, il établit une relation individuelle avec chacun », disait la regrettée Denise Barbeau, chercheuse et professeure de pédagogie à l’Université de Montréal.
Dans la philosophie de la réforme, on estime qu’un bon professeur n’est pas un acteur qui brûle les planches, mais un metteur en scène qui fait jouer l’élève. « Quand un enseignant fait étalage de son savoir, on peut l’admirer, se dire : “Wow, quel formidable communicateur !” C’est très bien de l’être. Mais… ce n’est pas ce que l’on nous demande. Comme profs, notre travail est d’amener l’élève à développer ses connaissances », estimait Denise Barbeau. Bref, un bon prof est celui qui fait apprendre.
Les chercheurs s’entendent sur le fait que, pour y parvenir, il doit être honnête, humain et… affectueux. La dimension affective est comme l’essence dans le moteur. L’élève qui sent que son prof se préoccupe sincèrement de ses progrès sera plus motivé et apprendra mieux. S’il se heurte à des difficultés, il sera plus à même de les résoudre. Un bon prof doit stimuler sa curiosité afin que son désir de savoir soit plus fort que sa peur de se tromper.
Un tel enseignant posséderait donc un certain nombre de qualités humaines de base. Mais selon les spécialistes, il serait très difficile de tracer son portrait-robot. Les chercheurs en pédagogie de la première moitié du 20e siècle ont essayé. « Ils ont dressé la liste de 83 traits de personnalité qui n’étaient ni plus ni moins que les qualités d’un bon être humain : attentionné, enthousiaste… Ça n’a mené à rien ! » dit Clermont Gauthier, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en étude de la formation à l’enseignement, de l’Université Laval.
Les chercheurs ont eu plus de succès dans les décennies subséquentes en se penchant sur ce que faisaient certains profs pour être bons plutôt que sur ce qu’ils étaient. Ils ont observé que plusieurs méthodes maximisaient l’apprentissage. Les excellents enseignants les connaissaient d’instinct : l’élève apprend mieux dans un cadre défini où il sait ce qu’on attend de lui, quand on exige de lui qu’il soit actif en classe ou quand son prof donne du sens à la matière en la liant aux connaissances déjà acquises.
Pour François Guité, professeur d’anglais de 2e secondaire à l’école De Rochebelle, à Sainte-Foy, et auteur d’un blogue sur l’éducation, le bon prof est un passionné qui sait communiquer, se brancher sur la réalité de ses élèves et les motiver. « À mes débuts, ma plus grande surprise a été de m’apercevoir qu’à l’université on m’avait montré quoi enseigner, mais pas comment le faire », dit ce prof qui a plus de 20 ans de métier. Il a alors formé avec des collègues un groupe de lecture et de réflexion qui lui a permis d’améliorer ses méthodes.
Depuis, il n’a jamais cessé de s’informer, de discuter avec ses pairs, d’expérimenter des choses, de remettre ses certitudes en question. Au fil des ans, il a élaboré son propre système : ses protégés peuvent sortir de la classe quand ils veulent et sont très autonomes dans leur apprentissage. Et ça marche ! « Rendre l’élève responsable, c’est l’outiller pour la vie. On prépare les jeunes à des professions qui n’existent pas encore ! » dit-il.
S’il est plutôt favorable au renouveau pédagogique, aux projets, aux compétences transversales, François Guité craint une chose concernant la réforme : qu’elle dise trop aux enseignants quoi faire et comment le faire. « Il ne faudrait pas qu’on étouffe leur créativité. » Pour lui, l’enseignement est à la fois une science et un art. Le bon prof doit éviter les recettes pour jouer sur ces deux plans. « Il est comme le jazzman qui possède la science de la musique, mais qui laisse jouer son cœur. »
TROIS PROFS MODÈLES

Photo : Joannie Lafrenière
Geneviève St-Onge a l’enseignement dans le sang. Elle rêve depuis l’enfance de ce métier qu’ont aussi exercé son père, sa mère et sa sœur. Ce qui l’allume, c’est le contact avec les jeunes, davantage que la transmission du savoir. « Il n’y a rien de plus gratifiant que d’arriver à mettre dans sa poche un petit turbulent ou de faire passer son année à un élève en difficulté », raconte cette femme de 38 ans. Dans sa classe de 6e année de l’école Des Prés-Verts, à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle met parfois la matière de côté le temps de discussions en groupe sur toutes sortes de sujets — ce qu’elle appelle ses « périodes bla-bla ». « Mon but est que chaque enfant sache que je l’apprécie tel qu’il est ; que je m’intéresse à lui en tant qu’être humain, pas comme s’il était un numéro. »

Photo : Joannie Lafrenière
LES INTÉGRALES DE JEAN-FRANÇOIS
Nom : Jean-François Deslandes
Matière : mathématiques
Niveau : collégial
Par une chaude matinée ensoleillée, dans un cours d’été de mathématiques, une vingtaine de jeunes sont assis, ventilateur dans le toupet, pour apprendre à résoudre des intégrales. Ils devraient s’arracher les cheveux ou s’ennuyer. Mais non ! Les élèves du collège Marianopolis, à Westmount, sont concentrés, émettent leurs idées, rigolent et prennent des notes. Que se passe-t-il ici ?
Il se passe que l’énergumène qui officie devant la classe s’appelle Jean-François Deslandes et qu’il a un don pour l’enseignement. Sous sa craie, même les équations d’un demi-kilomètre ont l’air sympas. Sa gentillesse, sa douceur, son respect des jeunes et la clarté de ses explications donnent à chaque élève l’impression qu’il peut réussir. L’homme de 38 ans est si apprécié que, pendant des mois, en 2008, il a occupé le quatrième rang des meilleurs professeurs d’Amérique du Nord dans le site ratemyteachers.com, où votent les élèves ! S’il en est flatté, il se défend cependant de faire ce métier pour être populaire.
Jean-François Deslandes a toujours su qu’il deviendrait enseignant ; sa seule difficulté a été de choisir sa matière. « C’était vraiment la relation avec les élèves qui m’intéressait », dit-il. Le plus important, selon lui, est de créer un climat convivial où chaque élève, même le plus timide ou celui qui éprouve le plus de difficultés, sera à l’aise pour poser une question. Il aime s’adapter à différents groupes, trouver des façons de capter leur attention, par l’humour ou des exercices calqués sur la vraie vie. Et il demande conseil à ses collègues. « Je suis loin d’être le meilleur mathématicien ici », dit-il.
Enseignant depuis 13 ans, il a hâte de voir arriver, en septembre, les jeunes qui ont grandi avec la réforme. « Ce sera un beau défi. Je ne pense pas qu’ils seront plus faibles ; ils seront simplement différents. Il y a une chose qui ne change pas, malgré ce qu’on peut en dire : les élèves, en grande majorité, veulent apprendre. Ce n’est pas vrai qu’ils sont blasés. Ils sont tellement vivants ! »