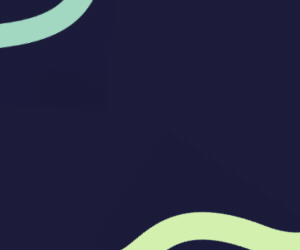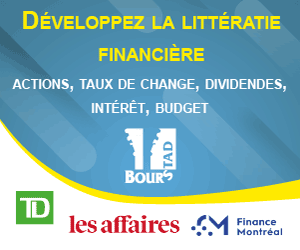Établissements
Qualifications Montréal
1050, 5e avenue Verdun, (QC),
Montréal,Québec
H4G 2Z
514 748-4646
http://qualificationmontreal.com/ et http://www.certifiecompetent.com/

Qualifications Montréal
Programmes offerts
1050, 5e avenue
Verdun, (QC), H4G 2Z6
514 748-4646
Courriel : info@qualificationmontreal.com
Site internet : http://qualificationmontreal.com/ et http://www.certifiecompetent.com/
Mission
Qualification Montréal est un guichet unique intersectoriel réunit l'ensemble des services de référence existants en reconnaissance des acquis et des compétences(RAC) sur l'île de Montréal. Qualification Montréal a pour mission principale d'accueillir et d'informer les éventuels candidats à la RAC sur l'éventail des services offerts et de les référer efficacement au bon endroit. Si vous avez acquis une solide expérience dans un domaine, vous pourriez obtenir, après évaluation et démonstration, un diplôme officiel en formation technique ou professionnelle.
De plus, Qualification Montréal regroupe également le service CertifiéCompétent, qui s’occupe de la reconnaissance des compétences de la main d’œuvre (RCMO), qui est également un processus d'évaluation et de reconnaissance de vos compétences professionnelles acquises à travers vos expériences de travail, rémunérées ou non. La RCMO mène à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, délivré par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
--------------------------------------------------------------------------------
Vous pouvez désormais suivre les activités de Qualification Montréal en reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) et en RCMO (reconnaissance des compétences de la main d’œuvre) sur leur page facebook ici : https://www.facebook.com/qualificationmontreal/
Programmes offerts : voir http://qualificationmontreal.com/programmes.php »