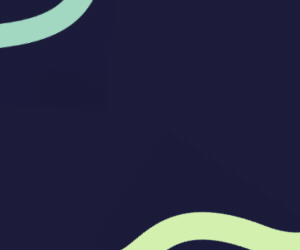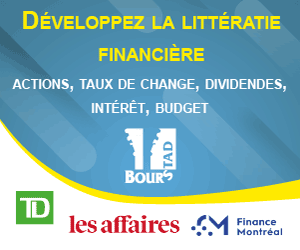Nouvelles
SRAM - La porte d’entrée vers trente-deux cégeps
30 janvier 2016 | Hélène Roulot-Ganzmann - Collaboratrice | Éducation/ Ce texte fait partie d'un cahier spécial./ Le Devoir.ca ----Pas besoin de sortir fraîchement de cinquième secondaire pour entrer au cégep, loin de là ! Selon les toutes dernières données du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), l’organisme qui centralise les demandes d’admission aux programmes de trente-deux cégeps dans tout le Québec, 46 % des candidats proviennent du secondaire adulte, du collégial, de l’université ou n’étaient pas du tout aux études au moment de la demande
30 janvier 2016 | Hélène Roulot-Ganzmann - Collaboratrice | Éducation/ Ce texte fait partie d'un cahier spécial./ Le Devoir.ca

Photo: Michaël Monnier
Pas besoin de sortir fraîchement de cinquième secondaire pour entrer au cégep, loin de là ! Selon les toutes dernières données du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), l’organisme qui centralise les demandes d’admission aux programmes de trente-deux cégeps dans tout le Québec, 46 % des candidats proviennent du secondaire adulte, du collégial, de l’université ou n’étaient pas du tout aux études au moment de la demande. Et ce n’est là qu’une donnée étonnante parmi tant d’autres.
Voilà maintenant plus de quarante ans que le SRAM gère les demandes d’admission aux différents programmes proposés par les cégeps. Pas tous, mais tout de même trente-deux sur les quarante-huit établissements publics que compte la province.
« Et pas tous à Montréal, précise Geneviève Lapointe, directrice des communications du SRAM. Ce qui a motivé la création de notre organisme en 1973, ça a été le désir des collèges de permettre au maximum d’étudiants d’obtenir une place. Les étudiants soumettaient jusque-là des demandes dans plusieurs établissements en même temps et ça congestionnait le système. Les plus forts étaient admis partout et les autres se voyaient refusés, alors que, bien entendu, les premiers reçus ne pouvaient occuper qu’une place. Au départ, il ne s’agissait que de collèges dans la grande région de Montréal, d’où notre appellation, mais au fur et à mesure de notre histoire, d’autres se sont ajoutés. Le nom est resté, mais le territoire que nous couvrons est beaucoup plus large aujourd’hui. »
Le SRAM voit donc le jour quelques années seulement après la création des cégeps en 1967. Et depuis, des dizaines de cohortes ont dû passer par ses filets pour se faire admettre dans le programme tant désiré.
Ainsi, l’automne dernier, le SRAM a reçu les demandes de 75 398 candidats. 61 976 d’entre eux ont finalement trouvé une place, soit un taux de placement de 82 %.
« Quatre sur cinq environ, confirme Mme Lapointe, c’est le taux que nous observons depuis plusieurs années. Si l’on considère en revanche seulement ceux qui ont fait une démarche d’admission complète, c’est 94 % qui ont été admis. Mieux, 89 % d’entre eux ont reçu une réponse positive pour le collège et le programme de leur premier choix. »
« Démarche complète », « premier choix »… il faut comprendre en effet que le système fonctionne en trois tours. Lors du premier, les étudiants sont invités à indiquer dans quel programme de quel collège ils souhaiteraient suivre leurs études. Et ce, avant le 1er mars. Les cégeps étudient alors toutes les demandes, font leur choix et indiquent au SRAM les places disponibles qu’il leur reste. Survient alors le deuxième tour.
« Les candidats qui n’ont pas eu leur premier choix obtiennent la liste des places restantes et sont invités à faire un deuxième choix, explique la directrice des communications. Même procédure de sélection ensuite de la part des collèges, qui fournissent à nouveau la liste des places restantes afin que nous effectuions le troisième tour. Le tout se termine fin mai. »
À ce petit jeu, les cégeps ne se retrouvent pas à la rentrée avec des places disponibles qui auraient pu être comblées par des étudiants tout à fait aptes. En fait, les candidats qui restent sur le carreau sont ceux qui n’avaient pas le niveau pour entrer au collège.
« C’est une petite portion, mais il y a notamment des gens qui viennent de l’étranger et à qui on demande une mise à niveau avant qu’ils puissent entrer au collège, note Geneviève Lapointe. On s’aperçoit d’ailleurs que, depuis une petite dizaine d’années, il y a une baisse des candidats en provenance de la cinquième secondaire. Ils étaient 60 % en 2008, ils ne sont plus que 54 % en 2015. Du fait de la situation démographique, bien sûr, mais aussi parce que des jeunes de cégep font des réorientations, d’autres interrompent leurs études avant d’y revenir. On croit souvent qu’il n’y a que des jeunes au cégep, mais entrez dans un collège, et vous allez voir qu’il y a des gens de tout âge ! »
Des étudiants majeurs
Ainsi, près de la moitié des candidats au cégep ont 18 ans et plus, et plus d’un tiers a même déjà atteint la vingtaine. Autre donnée intéressante, la part des femmes admises, qui, malgré des fluctuations au fil des ans, reste très majoritaire. À l’automne, en effet, les trente-deux cégeps ont admis 9258 femmes de plus que d’hommes. Une tendance installée qui fait d’ailleurs que, dans l’ensemble des établissements collégiaux du Québec, à l’automne 2014, on comptait 189 297 étudiants inscrits à l’enseignement général, 109 882 femmes et 79 415 hommes, soit 58 % de femmes.