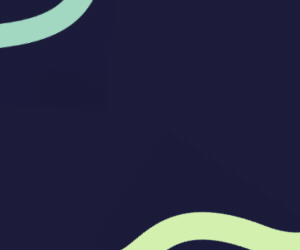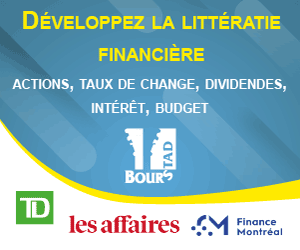Nouvelles
Prix Acfas Denise-Barbeau
Faire parler les textes

Photo: Jonathan Lorange C’est la découverte fortuite d’un manuel d’histoire littéraire canadienne ayant appartenu à son père qui aura été l’amorce du programme de recherches de Karine Cellard.
Par Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale
Le Devoir
Ce texte fait partie du cahier spécial Prix de l'Acfas
Karine Cellard est récompensée par l’Acfas pour ses travaux sur l’enseignement de la littérature.
C’est la découverte fortuite d’un manuel d’histoire littéraire canadienne ayant appartenu à son père qui aura été l’amorce du programme de recherche de Karine Cellard, professeure au Département de français du Cégep de l’Outaouais.
Le Prix Acfas Denise-Barbeau pour la recherche au collégial, qui lui est décerné, récompense une carrière prolifique dont le coup d’envoi aura été Leçons de littérature. Un siècle de manuels scolaires au Québec publié en 2011, jugé « magistral » et « profondément original » par la critique, et qui avait été son sujet de thèse quatre ans plus tôt. Cochercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ), elle réalise également d’importantes contributions à la série La vie littéraire au Québec (VLQ), de même qu’au Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature (LIREL).
« Je voue une grande reconnaissance au CRILCQ qui assure l’infrastructure de plusieurs projets de recherche. Sans eux, j’aurais eu beaucoup de mal à faire de la recherche au cégep, notamment pour obtenir les libérations de poste nécessaires. »
Dans un sous-sol près de chez vous
Mais il faut revenir sur ses premiers constats dans le sous-sol de ses parents à Trois-Rivières, qui sont à l’origine de ses champs d’intérêt ultérieurs sur l’institution littéraire québécoise et l’enseignement de la littérature.
Son baccalauréat et sa maîtrise en littérature à l’Université McGill l’avaient éveillée aux thèmes de la mémoire culturelle et de la transformation du sens dans le temps. Or, ce vieux manuel, qui date de 1957, la fascine tellement qu’elle décide d’en consulter de plus anciens, notamment la série de réédition d’Histoire de la littérature canadienne, signée Mgr Camille Roy. Elle découvre un jugement inversé sur tout ce qu’elle savait de la littérature. « Il se méfiait d’auteurs “moralement suspects”, comme Nelligan. Verlaine ou Baudelaire étaient des lectures déconseillées pour leur “génie inquiétant et malsain”. C’était surréaliste. »
Elle sait alors qu’elle tient son sujet. Son ouvrage sera le premier à aller au-delà de l’analyse de l’oeuvre de Camille Roy, pour la comparer aux manuels du temps de la Révolution tranquille, puis à ceux parus dans les années 1990, à la suite de la réforme Robillard. Les premiers ouvrages, imprégnés de morale, valorisaient la clarté, l’attachement national et même des canadianismes de bon aloi. Par la suite, on voit apparaître des manuels qui insistent soit sur la modernité intrinsèque de la littérature, soit sur la construction d’un nouveau récit national.
Trois générations après la mort de Duplessis, elle se dit frappée par le retour actuel de la morale. « C’est une nouvelle idéologie, plus individualiste, plus éclatée. On actualise les manuels avec des textes de femmes, d’Autochtones, de personnes issues de la diversité. C’est cohérent avec la sensibilité contemporaine, qui recherche des oeuvres du présent davantage que du passé, sans grand projet collectif. » Mais plutôt que de déplorer l’individualisme consumériste de la société actuelle et surtout la polarisation des discours, la professeure travaille à l’échelle de sa classe à encourager les étudiants à « faire société ».
« J’essaie de leur faire comprendre que cette transformation ne va pas de soi, qu’elle est aussi un produit de notre époque, avec ses qualités et ses défauts, et qu’elle dépend au moins un peu de nous, explique-t-elle. Il me semble que c’est un bel usage des possibilités de la littérature. »
Lire la
Renouveler l’enseignement